Café lumière
Réalisé par Hou Hsiao-hsien
Avec : Yo Hitoto, Tadanobu Asano, Masato Hagiwara
Scénario : Chu T'ien-wen
Titre Original : Kohi jikou
Durée : 1:49
Pays : Taiwan
Année : 2004
Site Officiel : Café lumière
|
|
Commande des studios Shochiku et de la NHK, ce nouveau chef d'œuvre du sémiologue taiwanais Hou Hsiao-hsien - enrubannant une chronique domestique languide sur l'évolution des mœurs - fut présenté comme un hommage lors du centenaire de la naissance du maître japonais Yasujiro Ozu. N'y cherchez pourtant aucune référence stylistique criante si ce n'est les scènes familiales et le rapport générationnel qui les taraude, clin d'œil complice aux histoires ancrées dans un noyau sociétal confronté à certaines mutations culturelles des parangons Le Voyage A Tokyo ou Printemps Tardif.
L'exercice avec lequel se collette le cinéaste ressemble aux pièces du compositeur Jiang Wenye dont Yoko, l'héroïne enceinte - qui heurte la bienséance en voulant élever seule à Tokyo un enfant dont le père réside à Taipeh -, s'évertue à débusquer dans le déluge urbain le café qui lui servait de refuge privilégié - spectre rétif capable d'envelopper, à l'instar d'une lumière soyeuse et attentive, la matière chaude et transpirante de l'inconscient. Esquissé à partir de la vie de la traductrice attitrée du réalisateur, le scénario doit énormément au travail d'épure de la romancière Chu Tien-wen, qui lui permet de s'épanouir en de limpides variations. Le regard est alors libre de se départir de la moindre défiance ou focalisation pour s'égarer, devenir poreux à la moindre sensation ou composition. La rigueur de la structure externe (découpage minimal, plans larges et diffus), hermétique à l'impression durable, permet aux sentiments d'affleurer dans un ennui artificiel, d'où un réalisme absent et éthéré. L'intensité presque improvisée de certaines séquences permettant des implosions dramaturgiques saisissantes (le mutisme du père, un aveu au milieu d'une rue bondée ou encore cette conversation nocturne entre Yoko et sa belle-mère). En effet, la tessiture transparente du film le nimbe d'une fascination idoine. De celle qui vous fait cruellement ressentir le manque et la vacuité.
Et le propos dilué à force de répétition de vouloir préserver son corpus, mieux de le nourrir en élargissant le cadre ou plutôt l'amnios d'un fœtus en devenir - gestation et affranchissement ontologique assujetti aux mutations spatiales. Terminé ce rai de lumière oblong ou cette fenêtre encombrée donnant sur la rue, une mégalopole se développe sous nos yeux en une temporalité suspendue (profusion d'horloges asthéniques). Alors que se dessine un horizon abscons, les protagonistes sont rejetés en marge dans un hiatus paradoxal (le prêt du parapluie) où la volonté de trouver sa place (le troupeau humain qui jalonne constamment l'arrière-plan) se heurte à la quiétude du cocon resserré d'une échoppe ou d'un plat exhumé de l'enfance. L'art de la disparition qui perle au sein du couple avide de liberté et figé sur ses racines célestes : de la photo (mémoire) naissant l'azur (plénitude et accord). Nous touchons alors en la croyance sacerdotale de l'artiste pour la métaphore et principalement le legs du temps, de la montre (Poussières Dans Le Vent). Obnubilé par la stase et les modalités temporelles (passé, présent, futur antérieur) le cinéma de HHH se fond dans la fertilité molle et les enregistrements du métronome, le lunaire Hajime.
Dès le premier plan-haïku, susurré et duveteux, une dualité est ressentie avec la légèreté flottante et mélancolique de l'évidence. Dans la nébuleuse lumière d'un astre d'été déclinant un wagon traverse placidement le cadre, filmé en contre-plongée avec une grâce confuse. Le spectateur et les personnages l'observent par le truchement de l'image tandis que la rame les toise en une évanescence indicible. Voici réinventée l'élégie iridescente ou l'obsession fétiche du cinéaste pour la juxtaposition de l'individuel et du collectif. Avec une préférence croissante pour le questionnement de la mémoire et de la transmission à l'échelle humaine. De ces caractères qui, à force de vivre dans une époque amorphe, deviennent littéralement le et leur temps. Abhorrant le passé - d'où la disparition de la dernière partie où Yoko se rendait chez un aïeul - ces êtres se retrouvent face à l'abîme, imperméables aux souvenirs, peu importe la direction choisie, il leur suffit de contempler et arpenter les rails.
Si loin, si proche, les deux rives s'épanchent dans une fraction chronologique distendue, lavée par l'empathie d'un quotidien usé, le long métrage assurant le lien feutré qui persiste entre elles. Ce sentiment spectral n'aura de cesse de s'incarner dans chaque interstice d'un enchevêtrement linéaire mais étonnamment complexe. Comme l'œuvre d'Hajime : au cœur d'un réseau de transport qui cajole et peigne le paysage gît un embryon oppressé. L'obscurité apposée à la lumière, les deux arches d'un pont entre néant et vie prégnante. Cette vacuité dilatée dicte son espace-temps au film par le mélange judicieux de fixité et de mouvement : théâtre hésitant voilé de pudeur et travaillé par l'inquiétude. Ceci autorisant une latitude vertigineuse à l'auditoire déambulant dans les venelles de ses sensations. Entre caractère statique et transitoire, l'enfant scrute l'adulte qu'il fait après avoir rejoint le convoi fractal de la maturité - celui qu'attendait Vicky lovée dans son hôtel à la fin de Milennium Mambo. Sorte d'écho magnétique entre deux cultures, deux villes, deux temps ou deux sexes. Stupeur de la forme d'impermanence saisie ici, nous assistons à un glissement vaporeux mais - nouveauté chez le cinéaste après Goodbye South, Goodbye ou Good Men, Good Women - entièrement souhaité et assumé par des protagonistes émancipés.
L'acoustique reste la seule émanation vibrante de corps diffus, imbibés de leur essence. Et le réalisateur de passer un cap pour délaisser le somatique et se concentrer sur un nouveau médium d'existence, les sons, relais emplis de spiritualité. Bruits et images jouant malicieusement à la surface des choses, de leur dissociation ou de leur décalage, mais surtout de leur incapacité à fusionner dans le présent. Jadis approche larvée de la technologie investissant les campagnes, l'allégorie du train rejoint le satori, l'illumination ou la réverbération d'une sagesse fuyante mais dont la recherche, induisant le coït du corps et de la mémoire, représente la respiration d'une vie.
Fredéric Flament
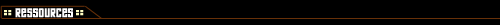
 |
