

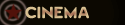

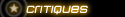


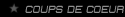
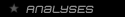






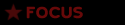

<-- AdButler 120x90 Code was here -->
|
En bonne compagnie
Réalisé par Paul Weitz
Avec : Dennis Quaid, Topher Grace, Scarlett Johansson, Selma Blair
Scénario : Paul Weitz
Titre Original : In good company
Durée : 1:49
Pays : USA
Année : 2005
Site Officiel : En bonne compagnie
|
|
Dan — Denis Quaid remis en selle par Loin Du Paradis — est l'heureux directeur du service publicitaire d'un grand périodique sportif. Père comblé de deux filles, il vient d'apprendre la nouvelle grossesse de son épouse. Fort de l'espoir de se voir enfin doté d'un fils, il se plonge avec enthousiasme dans son travail. Seulement le magazine est racheté par un magnat industriel qui chamboule l'organigramme en rétrogradant la quinquagénaire pour offrir son poste à un jeune loup déboussolé (Topher Grace au potentiel insoupçonné). Comble de l'ironie, le garçon tombe amoureux de l'aînée de Dan (Scarlett Johansson curieusement asexuée).
Sujet classique et modeste, maintes fois rabâché, que la mise en péril de l'american way of life par les débordements d'un capitalisme parricide. C'est celui que choisit pourtant de creuser Paul Weitz (Amercian Pie et Pour Un Garçon) dans un long métrage focalisé sur le flux résigné — valse des licenciements au gré d'une caméra métronome centrée sur un aquarium impavide. Le portrait d'une mondialisation odieuse ? En surface certainement, mais en filigrane insiste une impression subversive, celle de l'hémorragie chuchotée d'un espace fermé (la mère, la femme), étouffant et étriqué, vers un ouvert chargé de promesses (le père, prospecteur d'horizons). En cela la dernière image montrant plage et océan est suffisamment explicite après celle, forclose, projetée sur écran : malgré la naissance d'une fille la pérennité de la masculinité est entérinée.
Symboliquement le film aborde le passage et l'ouverture à soi : l'idée même de cordon ombilical avec la passerelle empruntée seul au début et à deux à la fin. Malheureusement, il veut faire montre d'une trop grande maîtrise des codes et son inclinaison à railler la paternité fanée, à vider de tout affect la notion de carcan social ou à restreindre ses enjeux dramatiques le rend emprunté, atone. A force de se placer à distance de la satire il s'en désynchronise et serait près de sombrer dans les ralentis sirupeux sur musique guimauve si ne persistaient des velléités larvaires de mise en scène, notamment dans les atermoiements du mariage de Topher Grace. Ainsi, au sein d'un bastion architectural entre Wright et Garnier, nous retrouvons une Selma Blair impressionnante d'immobilité cynique et un miroir mural narguant l'altérité somnambulique du couple.
La narration saigne jusqu'à s'éteindre, pourfendre les discours (salmigondis économiques désabusés) et vider les situations de leur essence (égratignement du happy end). L'aspect hédoniste disparu, le film se voit dénué de chairs, comme la lampe qui ne vacille plus sous l'effet d'une pichenette mais s'écrase au sol, mollement. Vision inféodée et sinistre de la métamorphose d'êtres quittant un nid cossu et tourbillonnant pour s'abîmer sur un récif déserté — le héros ne fait que rentrer dans sa résidence en stase, jamais nous ne verrons son processus physique de sortie. Etape essentielle traversée par l'héritier fordien qui, une fois las des marivaudages et des agitations bien vaines, rentrera au port retrouver sa nature, son double accorte et rassérénant. Moins que la ville ou la communauté (Friends, Sex & The City…), le motif qui taraude toujours la comédie américaine dans sa représentation des jeunes adultes demeure le foyer.
Frédéric Flament
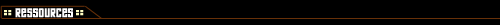
 |

Copyright ©1998-2006 LA PLUME NOIRE Tous droits réservés.
|
|
