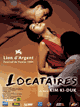Avec : Lee Seung-yeon, Jae Hee, Kwon Hyuk-ho, sud-coréen
Scénario : Kim Ki-duk
Titre Original : Binjip
Durée : 1:30
Pays : Corée du Sud
Année : 2005
Site Officiel : Locataires
|
|
De tous les adjectifs accolés au nom du réalisateur coréen Kim Ki-duk, on ne saurait retenir celui de talentueux. Syncrétique, prolifique et provocateur, certainement. Distillateur d'images imprégnatrices, parfois. Cinéphile dyspepsique à ses heures, à n'en pas douter. Quant à une quelconque virtuosité on cherche toujours, et ce n'est pas ce dernier opus en date qui viendra infirmer notre sentiment. Mieux, il cristallise avec brio les déficiences de son auteur (obsession martelée des symboles, poncifs grotesques rebutants ou cruauté obscène).
Jugez plutôt. L'essence même des longs métrages du cinéaste sud-coréen se situe dans un pessimisme racoleur sinon nihiliste en la nature humaine et par ricochet en sa propre capacité à échapper à ses pulsions. Aussi tel Tae-suk, héros amer qui déambule dans les rues à moto à la recherche de logements vides qu'il peut habiter quelques heures ou quelques jours, Kim Ki-duk se fourvoie dans la visite de vestiges glorieux de cinéma. Ne cherchez ainsi rien de sensationnel ici qui n'aurait été magnifié chez Tsai Ming-liang, Shoei Imamura, Hou Hsiao-hsien ou Takeshi Kitano pour ne citer que quelques représentants asiatiques contemporains.
Dans la même optique, analyser la progression de la filmographie de l'auteur revient à suivre le parcours du personnage central de Locataires. D'une idylle hargneuse même si intériorisée avec une femme battue (Adresse Inconnue, Crocodile…) on avance lentement vers une abstraction métaphorique aux relents esthétisants (sa plus grande réussite, qualifiée de " terroriste ", L'Île) pour s'embourber dans le balourd avec des images dépourvues de chair cohésive (Printemps, Eté, Automne, Hiver… Et Printemps et Samaria).
Les velléités de dénonciation d'une solitude aliénante, d'une schizophrénie chronique ou d'un consumériste castrateur existent bel et bien, seulement l'incurie de la mise en scène les départit de la moindre audace ou pertinence. Un total délaissement qui précipite un curieux délitement, sorte d'écho en négatif des feulements et espaces anxiogènes de 29 Palms, ce qui en stigmatise l'exceptionnelle vacuité. Se repaissant de sordide gratuit (le pistolet ou l'accident de voiture) et de pathos lénifiant (mari brutal et policiers véreux) le scénariste-réalisateur s'englue dans un récit non muet mais bien mutique en ce sens que non seulement aucun de ses protagonistes ne dialoguent - ou ne soliloquent - mais surtout qu'il n'essaie à aucune reprise d'instaurer un échange avec son spectateur, préférant l'errance au sein d'une hypnose vaguement comateuse. La dualité rêve-réalité qu'il revendique est alors habilement éludée, nous sommes aux antipodes des variations lynchiennes de Twin Peaks, Fire Walk With Me.
Ce film au moralisme absurde - cette dernière image et la quantification du poids de l'amour - n'aurait donc rien à nous dire, ce que confirme une dernière partie surréaliste particulièrement pénible. On suppute un propos mollement entomologiste ou les rapports humains s'envisageraient en surimpression, telle cette photo indélébile se transmuant en ombre monadique. La réalisation s'apparente alors plus à de la vannerie artisanale où le cinéaste s'évertuerait à croiser des bribes d'exosquelettes : des êtres décantés de toute matière par la répétition autiste d'un geste.
Carence d'originalité, inanité du propos. En définitive vraiment pas de quoi s'extasier !