Melinda et Melinda
Réalisé par
Avec : Radha Mitchell, Chloë Sevigny, Will Ferrell, Neil Pepe
Scénario :
Titre Original : Melinda and Melinda
Durée : 1:40
Pays : USA
Année : 2004
Site Officiel : Melinda et Melinda
|
|
a toujours été un auteur mineur, mais qui a su faire de ce trait caractéristique, une manière de résistance : du " cinéma - village ", estampillé pour jamais " juif new-yorkais ". Cela lui a coûté, c'est certain : il n'est guère que Paris pour prendre de ses nouvelles, hors la Big Apple. Si cet axe Paris - New York fonde bien la nature du dialogue entre Allen et ses spectateurs, on peut se dire que ça laisse peu de place au reste du monde, quand tous les grands comiques doivent tenir à une certaine cosmogonie. On peut se dire aussi que ce cinéma-là devient quand même, par la force des choses, un peu politique, au moins en regard des Etats-Unis 1.
Allen est mineur, mais il le sait. A partir de là, soit il essaie d'être quand même un cinéaste, et se frotte à des dispositifs. Soit il essaie de n'être plus un comique, et devient sérieux. Dans les deux cas, c'est souvent raté. Soit, enfin, il réalise des films à sa façon, et se fiche du reste. Alors, souvent, c'est mieux. Melinda et Melinda appartient à ce second cas de figure. Si dispositif il y a, celui-ci est suffisamment léger pour apporter, in fine, sa justification : deux auteurs, l'un dramatique l'autre comique, opposent leur vision des choses. Pour l'un, la vie est tragique, évidemment, triste à pleurer. Pour l'autre, elle est risible, peut-être absurde. C'est là que Woody, mine de rien, devient (un peu) cinéaste. Plutôt que d'être sérieux contre son statut de comique, il se pose la question du choix à faire, et partant, du regard. Si les deux auteurs se passent la parole, faisant défiler l'histoire de Melinda au fur et à mesure de son invention, il n'y a jamais deux Melinda comme semble l'indiquer le titre. C'est toujours la même, et quelque soit le démiurge qui la fait avancer, la nature tragique ou/et comique de ce qui lui arrive ne dépend pas d'un arbitraire. Allen laisse le spectateur choisir. Morale de l'histoire, évidente certes, mais qui a son mérite : on ne départagera rien ici, tout reste une question de point de vue.
Là-dessus, que fait le cinéaste ? Il se déprend comme parfois de ce qu'il sait le mieux faire : l'acteur. Cela importe peu, au fond, puisque son personnage n'est pas lui. Moins Charlot, moins burlesque de cinéma 2, au fond, qu'inventeur d'un débit de parole, d'une manière d'hypocondrie qui peut aussi bien se passer de corps, pour être incarnée par quelqu'un d'autre (ici Will Ferell, vu chez Mike Myers et Ben Stiller, peut-être choisi pour sa ressemblance avec G. W. Bush…) Quant à filmer des gens parler, de Central Park en appartements, aux prises avec leurs atermoiements sexuels et sentimentaux, c'est ce qu'il fait depuis toujours. Son corps n'a plus besoin de cette fonction de catalyseur, il peut aussi bien le prêter, ce qui revient à s'effacer, à évider le film de sa marque de fabrique (une présence). Et c'est précisément cette absence qui le rend à ses vertus (mineures) de cinéaste, comme si le système Allen devait se donner sans apprêt, dans sa minoration même. C'est limité certes, mais cela peut parfois, comme ici, être touchant.
1 D'abord parce que NY est le lieu d'un contre-pouvoir, ce que Paris n'est pas, lieu depuis lequel il s'exerce au contraire (d'où son occupation plutôt que sa résistance). Ce pourquoi on n'en veut jamais à de ne jamais voir ailleurs, quand le cinéma français d'obédience parisienne est si souvent fustigé.
2 En d'autres termes : vous enlevez les lunettes, reste lui-même. Si vous enlevez ses moustaches à Charlot, il devient Verdoux. Allen ne fait pas signe, il fait sens, sans passer par le signe. C'est pourquoi il reste dans l'ordre du langage, partant celui du scénario. C'est pourquoi il est assez peu cinéaste.
Sébastien Bénédict
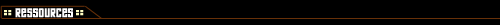
 |
