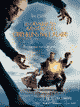La manne pécuniaire enfantine est-elle à ce point capitale pour l'industrie du divertissement ? Question pertinente tant les adaptations cinématographiques des best-sellers destinés à nos chères têtes blondes se bousculent à chaque période de congés. Dans le créneau de noël laissé vacant par la phagocytaire Harry Potter s'engouffre ainsi l'adaptation de la fable crépitante A Series of Unfortunate Events de Daniel Handler, comptant à ce jour onze volumes. Le récit grotesque et excitant - fusion aseptisée des trois premiers tomes de la saga - narre les mésaventures chroniques des trois orphelins Baudelaire : Violette, Klaus et Prunille. Après la mort mystérieuse de leurs parents dans l'incendie criminel de leur gigantesque demeure, ils sont placés sous la tutelle d'un abject parent, le comte Olaf, comédien raté avide du pharaonique héritage charrié par les chérubins. Une suite d'événements étranges et cruels va les mener sur la piste d'une conspiration et d'une obscure société secrète dont le signe fédérateur serait une longue-vue : symbole ostentatoire, comparé à l'il diabolique, de perspicacité et d'abnégation.
Les drolatiques saynètes de la fratrie Baudelaire emportées dans la gabegie d'une tornade d'épiphénomènes hétéroclites - vaguement reliés - procurent une sensation vénéneuse. Celle de l'écoulement inexorable et ironique d'un continuum.
Scélérate et complaisante la mise en scène indigente s'évanouit dans le décorum luxuriant et baroque, l'architecture somptueuse et biscornue, le casting opulent ou les rebondissements incessants. Malheureusement, si l'ambiance gothique - accolant mystère poussiéreux et technologie ludique façon Jules Verne - amalgame les scories décalées, elle anesthésie durablement l'atrocité sous-jacente ainsi que la faculté lunaire à exprimer les peurs enfantines.
La blême harmonie de l'envoûtant générique final dégorge sur l'ensemble du film. Lenteur amorphe et enchaînements primesautiers participent à la saveur de cette décoction putréfiée à l'envi. Mais l'onirisme bridé, que nous aurions préféré voir abordé par Tim Burton ou sous l'angle de la névrose chorale par Wes Anderson, résume avec une délectation perverse l'apprentissage de l'identité.
Entre transgression et répression, les Baudelaire tentent de se forger un système de valeurs autocentré (la lettre finale des parents et le legs de l'ouverture d'esprit). Et pour s'atteler à la quête d'une conscience calcinée quoi de mieux qu'un peintre anonyme ?
Le personnage d'Olaf est empoigné avec frénésie par un Jim Carrey, à l'apogée de son art gestuel et transformiste. La dextérité avec laquelle ce Nosferatu browningien joue de son corps désarticulé n'a d'égal que sa verve survoltée et son dynamisme effarant. Voyage initiatique blafard à qui une conclusion se dérobe avec opiniâtreté, le conte semble s'étendre exponentiellement à l'infini, se repaissant de ses propres restes pré-mâchés.