Aviator
Réalisé par Martin Scorsese
Avec : Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale, John C Reilly
Scénario : John Logan
Titre Original : The Aviator
Durée : 2:10
Pays : USA
Année : 2004
Site Officiel : Aviator
|
|
Hypothèse souvent vérifiée, l'a priori serait l'ennemi numéro un du super auteur. Prenez Scorsese : qui mieux que lui pouvait, a priori, réaliser un film sur le Christ ? Pas ce qu'il a fait de mieux, pourtant. Ce n'est plus un mystère, les obsessions d'un cinéaste ne doivent jamais constituer un sujet, mais passer par lui, au contraire, selon les codes implicites d'un virus qui affecterait l'ensemble. Scorsese sait bien, pour l'avoir énoncé sur un chapitre entier de son Voyage à travers le cinéma américain, ce qu'il doit à l'influence des " contrebandiers ", et parmi eux à celle, éminente, de Welles.
Avec The Aviator, le cinéaste navigue à vue entre facilité déconcertante, ultra lisibilité de chaque scène, usant d'effets de sens immédiats qui empruntent surtout à la vignette, et infusion progressive de ce mal qui l'occupe depuis le début, mal organique, stigmate, collusion allégorique entre corps et sacré dont Raging Bull reste l'exemple le plus puissant.
Là-dessus, pas de surprise. Ce biopic de Howard Hughes n'est pas sans parenté avec celui de William Randolph Hearst, autre magnat visionnaire, dont Welles fit sa carte de visite en 1941 : " Citizen Hughes ", donc, rien de moins, serait le sous-titre de ce qui nous occupe. Là encore, ce que l'on nous montre est aussi bien ce que l'on nous cache, l'allégorie marche à plein, et la geste scorsesienne peut se déployer sans ambages du déploiement de ses forces telluriques (le tournage du film Hell's Angels avec coucous d'époque) à l'affaire privée de son personnage, de la grande à la petite histoire. Ce va-et-vient connu trouve ici une manière de néo-classicisme à l'endroit d'une modernité qui commence à dater (Citizen Kane, donc), mais que le cinéaste s'emploie à relier au présent de son cinéma. Et plus précisément au corps de son acteur, Leonardo Di Caprio, figure virginale sur laquelle le temps semble s'être arrêté. Ce dépli du temps, de la mémoire cinéphile incarné par un corps dont la jeunesse semble éternelle, permet au film comme à son héros d'accéder au fantasme de Dorian Gray, antidote au mal qui ronge, santé indéfectible qui contredit l'idée de " grand film malade " chère à Truffaut pour justifier les ratages apparents de ses auteurs favoris. Ici, les stigmates du personnage sont apparentés à des troubles obsessionnels compulsifs, hérités d'une mère trop attentive à la pureté et disparue jeune, précisément emportée par l'objet de sa peur : la mort et la maladie.
Mais l'ordinaire du mal scorsesien change de cap : non plus sa mise en spectacle progressive (idéalement sur un ring, sinon dans la rue), mais une manière honteuse de se cacher, de n'en surtout rien révéler. La hantise du mal ne resurgit pas de la dépense physique, elle n'y transpire que par accident. Où d'autres devaient faire de leur corps un théâtre, Hughes cherche à le faire oublier. Son masque de jeunesse l'y aide, même s'il répugne au nom de " Junior ", par où son corps à lui ne sera dépositaire que d'un ordinaire du rêve américain : photos sur magazines, liaisons médiatisées, accélération de l'Histoire, celle de l'aviation et partant de l'Amérique. Le supplice, autrement dit, doit rester confiné à l'origine, dans l'ouverture du film où la mère communique ses peurs à Hughes enfant.
Pour le reste, Scorsese déploie la figure du visionnaire au diapason de sa couverture médiatique, dans le caméo (Blanchett en Katharine Hepburn, Jude Law en Errol Flynn), la reconstitution apprêtée, le tout décorum. Si le mal est toujours à l'origine de son dépassement par la création, il s'offre ici comme son pli inverse, par où les deux ne s'imbriquent plus l'un dans l'autre mais se combattent, par où Scorsese, bien évidemment, s'identifie à Howard Hughes, et cherche à faire oublier ses affres pour lui substituer la seule facilité. Mais puisqu'il faut bien y revenir, ce sera dans l'interstice secret qui ouvre le film à son mitan, dans la salle de projection qui éloigne Hughes des regards de la presse, pour le laisser seul avec son mal. Brûlé sur une large partie du corps par un grave accident d'avion, il se fait projeter les images de ses films et s'interpose entre la lumière et l'écran.
Sans métaphore aucune, cette fois, le cinéaste dépasse l'allégorie pour accéder au figuratif pur, à son objet pour toujours : l'image qui se projette sur la peau stigmatisée, sur le réel le plus tangible. Image comme épiderme dans sa plus vive trivialité, peau-écran qui accueille le réel et le révèle. Mais tout cela, encore une fois, est affaire de chambre noire, de secrète coulisse dont Scorsese nous ouvre un instant, un instant seulement, la porte interdite. Il se risque un temps à nous découvrir sa Passion à lui, lui seul, pour aussitôt repartir à l'assaut du ciel.
Sébastien Bénédict
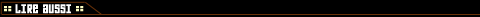
 Les Infiltrés Les Infiltrés
 Gangs of New York Gangs of New York
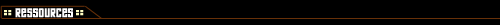
|
