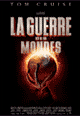La Guerre des mondes
Réalisé par Steven Spielberg
Avec : Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Miranda Otto
Scénario : David Koepp
Titre Original : War of the worlds
Durée : 1:56
Pays : USA
Année : 2005
Site Officiel : La Guerre des mondes
|
|
Du nouveau ? Certes. E.T. n'est plus ici. La communication, ce grand fantasme spielbergien, a été coupée. Over. Livrés à eux-mêmes,, des personnages en manque vont aller jusqu'au bout de la nuit, tenter d'en revenir. Happy end possible ? Il n'empêche : le mal est fait.
En quoi le nouveau Spielberg est-il nouveau ? Autrement dit, qu'est-ce qui en fait un film en plus, plutôt qu'un film de plus ? Qu'il s'agisse là d'une somme, tout le monde en conviendra, vaste entreprise à recycler tout ce qui a précédé dans le cinéma de Spielberg. Mais rien ici ne vient terminer quoi que se soit : nul testament. Il s'agit juste du meilleur film de son auteur.
Si La guerre des Mondes arrive après, en plus, c'est d'abord comme chef-d'œuvre, au sens propre : en tête de l'œuvre, loin devant tous les autres. A cela, une évidente raison. Spielberg s'invente sprinter hors paire, déploie dans la première heure une vitesse d'attaque au moins aussi efficace que celle des envahisseurs. Quelques scènes suffisent, hitchcockienne et précieuse leçon, à dessiner un personnage, planter un décor, démarrer le film. Famille décomposée, père largué, quelques balles avec le fils rebelle qui bientôt prend la voiture sans autorisation, pourchassé par son géniteur. Qui arrive en trombe dans la rue, tombe sur ses voisins fascinés regardant derrière lui.
Champ (la vie ordinaire, banlieusarde, décrite avec une réelle finesse de regard). Contrechamp : le film peut démarrer, en trombe, c'est le cas de le dire, un orage se déchaîne, et là , alors qu'on le croyait à bout de souffle, Spielberg passe la seconde, embraye sur l'attaque en une série de séquences inouïes, chaos par deux fois référencé : entre Holocauste et 11/09, hier et aujourd'hui, chacun fuit sans comprendre l'horreur génocidaire.
Cinéma paranoïaque ? Au dernier degré. Réactivation de la grande peur ? Oui. Mais nulle idéologie réactionnaire. Mieux, Spielberg avance depuis quelques films habités par la perte, vers l'ère du doute le plus profond. Sa maîtrise laisse progressivement place au vacillement, à ce qui, dans l'image pourtant ad hoc manque, vient à faire trembler l'édifice comme château de cartes. Ce qui manque ? Toujours un fils, une fille, ou un père. Fiction familialiste, mais dégénérée par l'angoisse du lien rompu, plus petit dénominateur commun de la grande forme collective, de sa grande peur donc. En un sens, il y a bien somme, dans cette obsession du manque qui conduit Spielberg à l'éprouver à l'échelle planétaire.
Ray Ferrier (Tom Cruise), choisit comme les autres de fuir devant l'attaque, entame sa Nuit du chasseur à lui, en compagnie de son grand fils (qui le déteste), de sa fille régulièrement en proie à des crises de panique. Repli inévitable, alors, sur la petite famille, mais qui ne cesse de devoir rendre des comptes au reste de l'humanité, laquelle ne se laisse pas facilement oublier. La famille non plus : les deux enfants n'arrêtent pas de réprimander leur père, de le renvoyer à ce qu'il n'est pas pour eux (un père, justement).
C'est par le collectif, par l'horreur possible au détour d'un plan, que celui-ci devra se justifier en tant que tel. Lui que sa fille, en particulier, va rendre au monde et non l'inverse. Spielberg n'a jamais été un cinéaste paternaliste. Plus que jamais, il est ce grand malade qui dépense des millions en psychanalyse, un obsessionnel qui désormais se laisse volontiers dépasser par son obsession. Comme l'enfant robot de A.I., l'adolescent multiple de Catch Me, Ferrier est un monstre, un personnage en manque, un creux qu'il faut remplir. Ces personnages ne dérivent jamais de leur but, qui les conduit, au sens propre, à pied à cheval en voiture, vers ce qui manque en eux. Depuis quelques temps, Spielberg ne met en scène que des odyssées. Retour à la grande fiction primitive, La guerre des Mondes fonctionne sur la cohabitation du repli et de l'ouverture, de l'obsession et de ce qui la contrarie, finit par l'endiguer : plus que jamais, le cinéaste intègre ici l'Amérique contemporaine à son histoire.
Ne pas oublier l'enfant, toujours lui, qui du père à sa progéniture, fait la ressemblance : Ferrier, à la moindre occasion, ferme les yeux de sa fille, voudrait la préserver de l'horreur du monde. A l'injonction répétée (" ne regarde pas "), Ferrier oppose la nécessité pour lui de voir, voir sa fille, coûte que coûte. Alors qu'elle demande à s'arrêter sur le bord de la route pour un besoin pressant, il lui ordonne de rester en vue. Bien sûr, elle oppose sa pudeur et s'éloigne, non sans l'avoir traité, à juste titre, de malade. C'est en échappant au regard possessif du père qu'elle va éprouver alors son propre regard : découvrir sur le fleuve en amont un premier cadavre, puis deux, trois, une multitude enfin.
Ce que le père lui cache, Spielberg n'hésite pas à le lui montrer. Plus tard, Ferrier bande les yeux de la gamine et s'en va tuer un résistant fou qui les a accueillis, devenu trop dangereux pour lui comme pour elle. Meurtre inutile (ils seront de toute façon découverts par les envahisseurs), et pas en avant dans la monstruosité du personnage. Cette fois, c'est lui qui se cache à sa fille, incarne l'horreur, doit en passer par elle. Point de non-retour, cette scène ne manquera pas d'en choquer plus d'un. Elle ne dit pourtant rien d'autre que le degré maladif de l'obsession, sa sourde terreur. Là , dans le hors champ, entre deux images, le cinéaste fait saigner la béance, résonner le manque en un geste désespéré. Ferrier devient le croque-mitaine, doit en passer par la figure du loup s'il veut garder sa fille, se mouiller, littéralement, dans le conte auquel il la convie. Dès lors, l'enfant n'est plus toute seule, et plutôt que de la tenir éloignée de sa peur, le père préfère en devenir l'objet tacite. S'il en résulte un surcroît d'héroïsme inévitable dans la scène suivante, Spielberg aura toutefois été aussi loin qu'il pouvait. Ramenant ses personnages à égalité, il donne à son cinéma une stature moins directement enfantine : cette fois, l'adulte et l'enfant peuvent enfin cohabiter.
Sébastien Bénédict
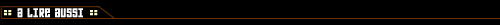
 ArrĂŞte-moi si tu peux ArrĂŞte-moi si tu peux
 Minority Report Minority Report
 A.I. Artificial Intelligence A.I. Artificial Intelligence
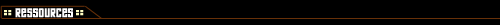
|