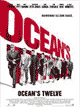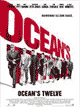

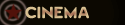

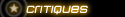


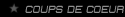
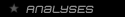






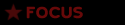

<-- AdButler 120x90 Code was here -->
|
Ocean's 12
Réalisé par Steven Soderbergh
Avec : George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones
Scénario : George Nolfi
Titre Original : Ocean's twelve
Durée : 2:05
Pays : USA
Année : 2004
Site Officiel : Ocean's 12
|
|
Le succès planétaire du premier casse aidant - Ocean's Eleven débridé, fluide et éblouissant, avec son groupe de onze cambrioleurs enjôleurs (George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon…) -, voici la livraison attendue de la suite des aventures atmosphériques des acolytes facétieux de Danny Ocean.
Au programme un déluge de glamour, toujours plus de clins d'œil désopilants, une kyrielle de mises en abîme et une autodérision proclamée (ou comment railler les lieux communs écornant les stars sur un ton tantôt entendu, tantôt euphorique) sans oublier le rejet propret de tout syllogisme. Une fois la décontraction adoubée, restait à trouver un prétexte composite pour entériner le second opus. C'est chose faite lorsque le dandy floué du premier épisode (Andy Garcia) débarque dans la retraite dorée de chacun de nos compères pour exiger, manu militari, le remboursement de la somme prélevée dans les coffres de son casino sans compter les intérêts courant sur les trois années écoulées depuis le fameux coup de maître. Revoici nos voleurs et consorts obligés de s'aventurer sur les chemins délictueux afin de sauver leurs existences menacées. Ils ne tardent pas à s'apercevoir qu'un orfèvre crâne et français de la cambriole (Vincent Cassel cabotinant à loisir) est la cause de tous leurs ennuis. Sans compter qu'une escale aux Pays-Bas lance la tourbillonnante Catherine Zeta-Jones sur leur piste balisée.
Il ne s'agit plus dès lors que d'un voyage opulent et sybarite aux quatre coins de l'Europe durant lequel se dilue un éloge de la simplicité ; avec seule ambition d'abolir la distance pour coller, tel un scapulaire, à l'épiderme (haute couture amidonnée) des acteurs. Comme Brad Pitt dans le prologue, le spectateur est invité à s'échapper du cadre mythique du passé pour plonger abruptement dans un ersatz d'ordinaire dont l'inanité engendre un charme débonnaire. Le cinéaste s'employant à privilégier allégresse et fantaisie au détriment d'un récit qu'il sait inconsistant. Mais le trop-plein d'élégance et de voies embrouillées - flirtant par instant avec le jazz empesé d'un Mike Figgis - met en péril l'équilibre précaire de cette brillante sarabande jusqu'à l'enliser et vérifier l'adage qui veut qu'à force de trop embrasser on étreint fort mal.
La situation du long métrage est de fait paradoxale puisqu'il s'appuie exclusivement sur un maniérisme qu'il abhorre dans ses chairs. Effets de montage (recadrages, flash-back…), afféteries en pagaille ou propension à imager les non-dits participent à une volonté d'effacer la parole signifiante au profit de portraits complaisants des différents mastodontes hollywoodiens et de musiques souvent tonitruantes. Dénué d'enjeux même minimalistes, il n'est plus question d'habiller le film d'un script babillant ou mousseux (à la manière du splendide Un Jour Sans Fin) mais bien d'ériger ce supplément d'âme comme unique sujet d'un objet purement ludique. D'où ses arômes, tour à tour délectables - plaisir aérien et volutes savoureuses dignes d'une œuvre d'Howard Hawks - et vains - essoufflement d'une conclusion frelatée à tiroirs.
Fredéric Flament
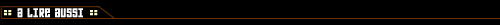
 Ocean's Eleven Ocean's Eleven
 Che Che
 Eros Eros
 Full Frontal Full Frontal
 Traffic Traffic
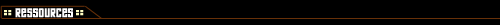
|

Copyright ©1998-2006 LA PLUME NOIRE Tous droits réservés.
|
|