Punch-drunk love
Réalisé par Paul Thomas Anderson
Avec : Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman, Luis Guzman
Durée : 1:31
Pays : USA
Année : 2002
Web : Site Officiel
Basé sur : Script
|
|
Certains films ne sont qu'œuvres de transparence, prêtant le flanc volontairement à la stupeur par leur douce naïveté affichée. Introduction qui sied au 4ème film de Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love (« Sonné par l'amour »), œuvre réflexive qui clame doucement son plaisir de la mise en scène.
Ce film, on pourrait le résumer comme l'histoire d'un metteur en scène qui cherche à capturer un personnage dans le champ de sa caméra ; un film d'apprentissage, un film de dompteur. Un film qui de fait échappe à un genre bien défini. Le pitch officiel dira qu'il s'agit de l'histoire de Barry (Adam Sandler, étriqué donc burlesque), médiocre manager d'une petite entreprise de ventouses pour toilettes, matronné par sept sœurs envahissantes, à la vie sentimentale inexistante, et dont le seul centre d'intérêt semble être la collecte de bons de réductions sur des paquets de pudding pour gagner des miles d'avion gratuits. Homme allergique à la société et à son entourage, qui se débat au milieu des convenances, il exprime son malaise en évitant la caméra. Il dodeline, tourne le dos, s'isole, se réfugie dans les coins (le premier plan du film le surprend au fond du champ, au bord du cadre) ; il trépigne, ne supporte pas de rester en place, soumis à notre regard et à celui des autres, oblige la caméra à user de constants panoramiques pour le garder en vue.
Mais un personnage aussi retors, ça se dompte ; pour cela, des appâts sont nécessaires, deux précisément : la rencontre d'une femme déjà séduite par lui (Emily Watson), et un chantage traumatisant qu'il subit pour avoir pris contact avec un téléphone rose. Il fait alors son apprentissage de l'amour et de la colère. Il se met en mouvement, modifie ses gestes, son attitude, dans son rapport à la caméra : la course au bonheur commence. Le film devient la croisée des chemins entre le film burlesque aux longues courses effrénées (Buster Keaton bien sûr), et la comédie musicale avec sa déformation du réel. La mise en scène transcende cette histoire en lui donnant un cadre cinématographique approprié. Et ce qui devait être un film pathétique glauque à la Todd Solontz, se transforme en bluette légère et frénétique. Tout s'accélère, se simplifie, se raccourcit (les distances, le temps), les couleurs s'affichent en Technicolor (le bleu de son costume contre le rouge de sa robe). La danse se met en place, les premiers pas s'enchaînent timides, puis assurés.
Cet apprentissage de la vie fait écho à celui de la mise en scène ; comme si filmer signifiait accomplir un personnage ; comme si filmer un homme qui marche, c'est le faire avant qu'il ne se mette à danser. Une réflexivité d'autant plus habile qu'elle rejette toute prétention visuelle, se contentant de participer à la déconstruction de son récit par l'incrustation de tableaux de couleurs et par une musique souvent bruitiste omniprésente, qui associée aux images évoque la séance d'accordage d'un orchestre avant concert.
L'histoire d'une mise en scène qui se satisfait du seul fait d'exister. Le plaisir mélo de cette histoire d'amour peut suffire à la justifier. Mais à ce niveau de jugement, il est plus sage pour le critique de boucler habilement son texte et de conclure à la logique de la récompense cannoise du prix de la mise en scène pour ce film, qui une fois n'est pas coutume, n'apparaît pas comme un simple prix de consolation ou de compensation.
Raki Gnaba
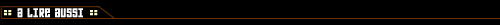
 Magnolia Magnolia
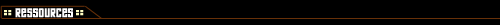

|
